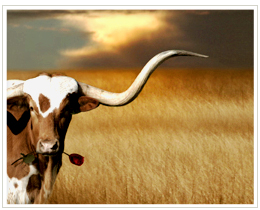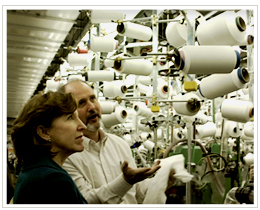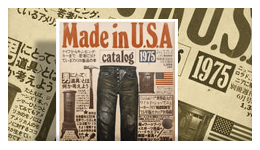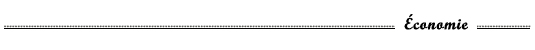
A l’heur où l’on reparle de la réindustrialisation probable - mais partielle - des États-Unis, notamment grâce au rapport du Boston Consulting Group que nous avions analysé ici et qui répand cette idée dans la presse (ici, ou là) ; que certains milieux d’affaires usaniens lancent des initiatives pour la relocalisation de la production ; les statistiques du Bureau du travail permettent de se rendre compte dans le détail de l’évolution de l’emploi à moyen terme (10 ans) dans les différentes branches du secteur industriel américain et donc de faire un bilan.
Tous les graphiques suivant donnent le nombre d’emplois en milliers, sur la période allant de janvier 2002 à avril 2012 et respectent l’ordre de classement des statistiques usaniennes. Les chiffres sont corrigés des variations saisonnières.
Industries, toutes branches confondues.
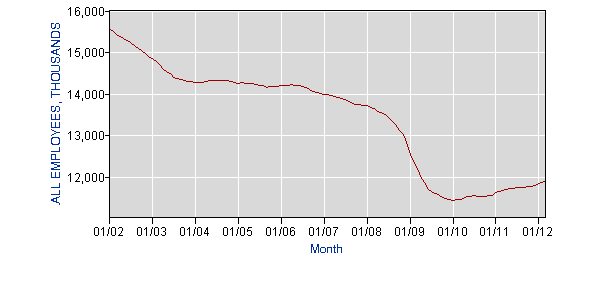
Le premier constat à faire est la chute importante d’effectif que les manufactures ont connu dans la décennie écoulée. Entre 2000 et 2010, l’industrie américaine a perdu près de 7 millions d’emplois passant de plus 24,6 à un peu plus de 17,6 millions de personnes employés. À titre de comparaison, les manufactures seules ne perdirent que deux millions d’emplois environ entre 1985 et 2000. Elles en ont perdus 6 millions environ entre 2000 et 2010 (voir ci-dessous).
Depuis 2010, la courbe s’inverse. Les manufactures embauchent à nouveau et 500.000 emplois ont été créé en un peu plus de deux ans.
Les biens durables
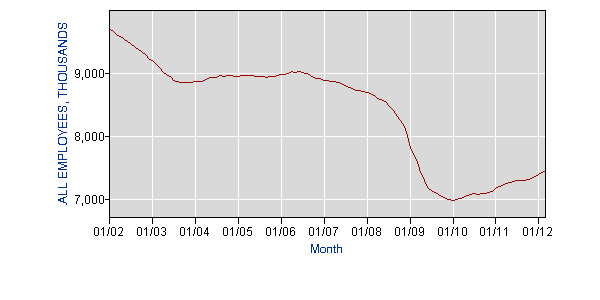
La production de biens durables emploient à peu près les deux tiers (7 millions) des travailleurs des manufactures. Il a évidemment connut une évolution comparable à l’ensemble du secteur. Une perte de 3 millions d’emplois sur la décennie et à peu près 500.000 emplois recréés depuis 2010. C’est la production de biens durables qui tire la croissance des industries américaines depuis deux ans.
Au sein de ce sous-secteur, les évolutions sont néanmoins contrastées.
- Les produits du bois (de la production de parquets aux maisons préfabriquées) ont perdu 200.000 postes lors de la crise et stagnent depuis 2010. [1].
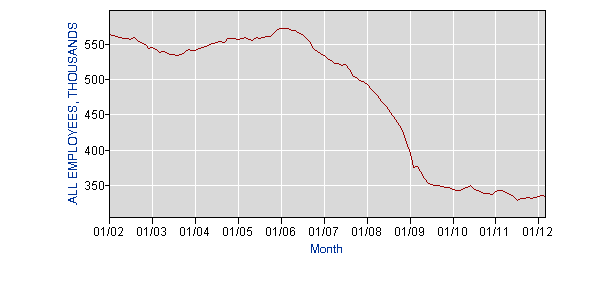
- Les produits à base de minerais non métalliques (le sable, les graviers, la pierre, etc.) sont dans une situation similaires [2].
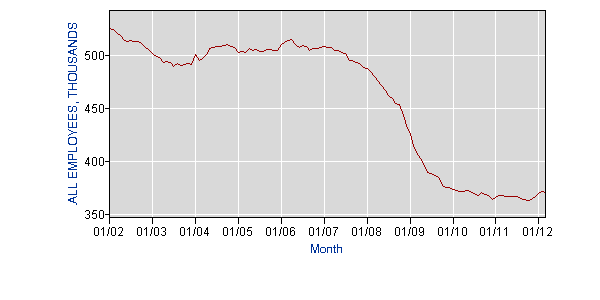
- Les industries de transformation primaires, qui transforment les minerais ferreux ou non pour leur utilisations industrielles ou autres, ont retrouvé 50.000 des 100.000 emplois perdus avec la crise. Ce secteur plafonnait alors autour de 450.000 emplois et semble devoir les retrouver si l’économie américaine renoue avec la croissance. Ces industries étant fondamentales pour tout le reste [3].
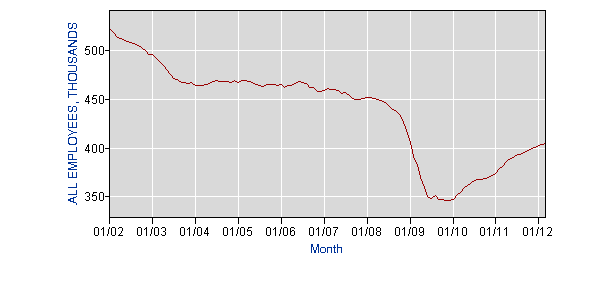
- Les industries de produits finis ou intermédiaires en métal, autrement dit tous les produits issus des forges, des aciéries, etc, connaissent une très nette reprise depuis 2010, preuve qu’une certaine forme d’industrie repart à la hausse en Amérique. C’est d’autant plus important que ce secteur emploie beaucoup de monde, soit près de 1,4 millions de travailleurs en avril 2012. Néanmoins, si 140.000 emplois ont été recréé dans ce secteur depuis 2010, les niveaux d’avant-crise ne sont pas encore recouvrés [4].
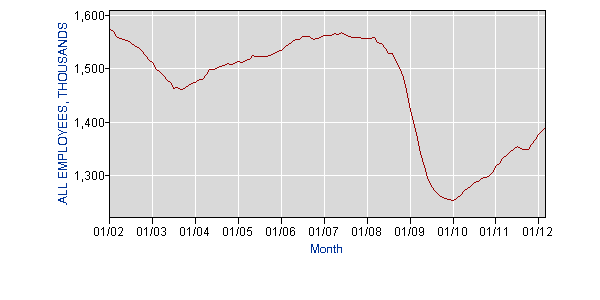
- Selon la même logique que le secteur précédent, et parce qu’il sont, dans les faits, très proche, les industries de fabrication de machines-outils repartent elles-aussi à la hausse depuis 2010 avec la création de 130.000 emplois depuis cette date. Là encore, nous sommes dans des secteurs qui emploient beaucoup : 1,1 millions de personnes en avril 2012 contre 1,2 en 2008, mais 1,15 millions en décembre 2004. À moyen terme, et malgré des années de croissance ou de récupération entre les crises, ces secteurs perdent des emplois. Au tournant du siècle, les machines-outils américaines faisaient travailler plus de 1,3 millions de personnes [5].
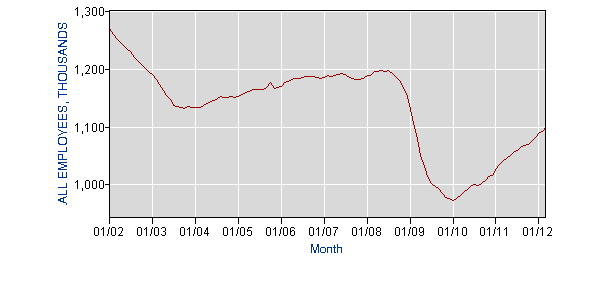
- Le secteur des ordinateurs et des produits électroniques n’a, lui, connut aucune reprise. Il a cependant enrayé sa chute depuis 2010, peut-être grâce à la relocalisation de certaines entreprises comme Zentech, mais il stagne un peu comme dans les années 2003-2007, ce qui n’a pas empêché une perte massive d’emplois : plus de 500.000 entre 2002 et 2012 [6].
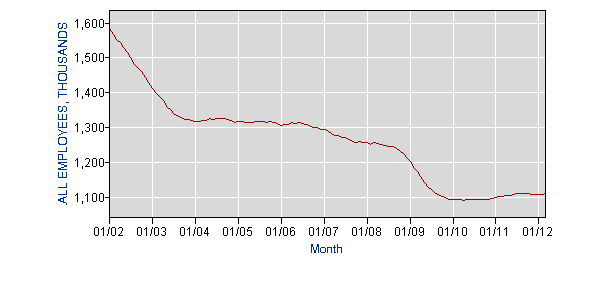
- Les équipements et appareils électriques (des moteurs électriques à la fabrication d’ampoules), comme l’électronique, perdent des emplois à moyen terme, même si, ici, les volumes d’emplois sont moins important [7].
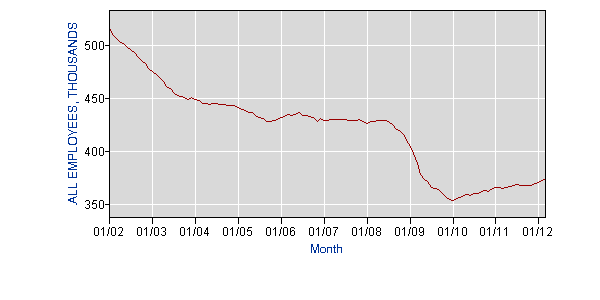
- Secteur phare par excellence, l’automobile et les transports repartent également à la hausse... après avoir perdu plus de 600.000 emplois entre l’an 2000 et la fin de l’année 2009 ! C’est ici que se mesure toute la faillite de l’industrie automobile de Détroit par exemple. Il se vendait en moyenne 16 à 17 millions de voitures neuves par ans depuis le début des années 2000, chiffre tombé à 9,5 millions durant la crise. La reprise pour le moment est encore limitée : 140.000 emplois ont été recréés en deux ans dans ce secteur [8] mais certains commentateurs, comme Jeremy Cato du Globe and Mail, chante le retour des belles années. À voir.
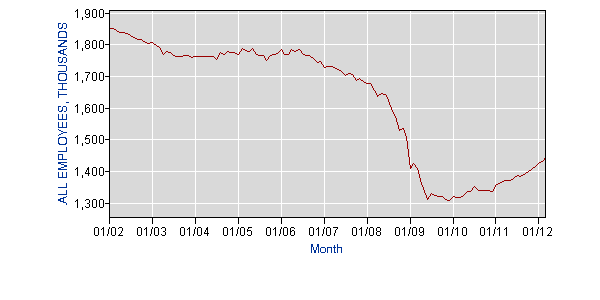
En complément, voici la courbe du sous-secteur des moteurs et pièces détachées qui a recouvré l’essentiel des emplois du secteur.
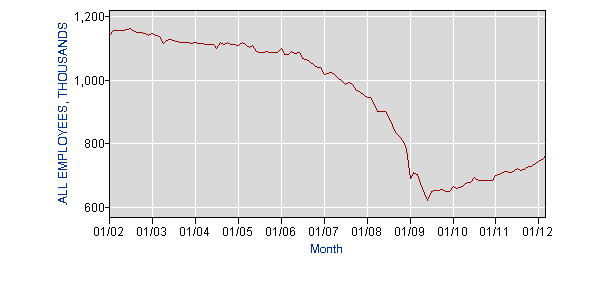
- Pour terminer avec les biens durables, le secteur de l’ameublement et des produits associés qui va des volets aux meubles de style, en bois, en métals ou en plastique, poursuit sa chute : en 10 ans, il aura perdu près de 300.000 emplois, soit la moitié de ses effectifs [9].
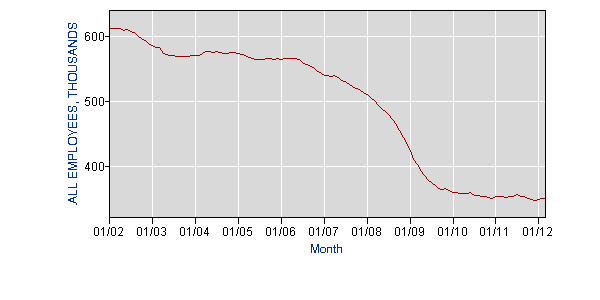
Les biens non durables, globalement, n’échappent pas à la règle de la désindustrialisation usanienne. En 10 ans, toute cette branche de l’industrie aura perdu plus d’1,5 millions d’emplois. Cependant, après une chute régulière entre 2002 et 2008 qui s’est achevée par la brusque perte de 500.000 emplois en un an en 2008-2009, le secteur semble stabilisé. Il emploie un peu moins de 4,5 millions de personnes depuis 2010.
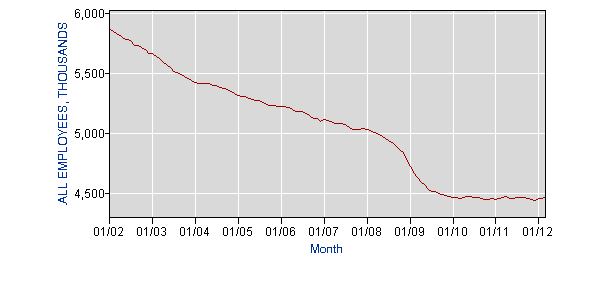
La majorité des branches qui le composent suivent donc une évolution à peu près similaire : perte régulière d’emplois depuis 2000 et au mieux une certaine stabilisation ou ralentissement de la chute depuis 2010. Certaines branches connaissent cependant des évolutions plus contrastées.
- L’industrie alimentaire (des abattoirs aux plats préparés) connait une évolution en dent de scie mais ne cesse de perdre des emplois : un peu moins de 100.000 sur la décennie.
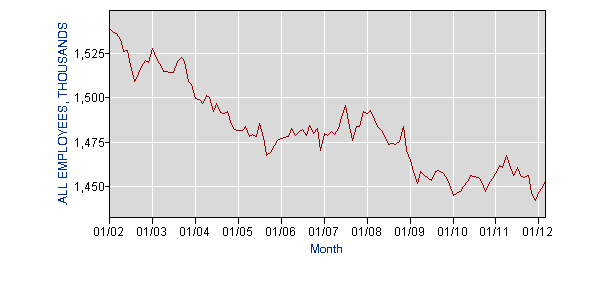
- En revanche, la branche voisine des boissons et du tabac connait une forte reprise depuis 2010. Les niveaux d’emplois sont cependant beaucoup moins important.
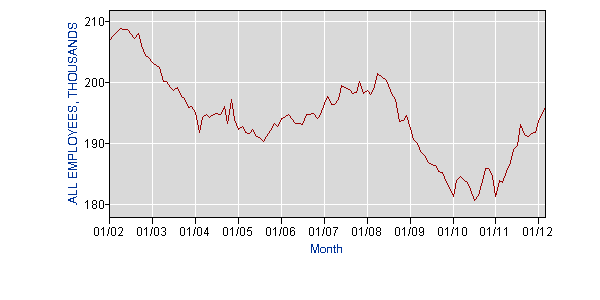
- Le textile, filatures ou confection, connaît une évolution similaire à la courbe générale. Dans ces secteurs en concurrence directe avec les mains-d’œuvre chinoises ou asiatiques et qui n’emploient plus que quelques centaines de milliers de travailleurs, la stabilisation des pertes d’emplois depuis 2010 peut être malgré tout perçue comme un point positif.
Les filatures :
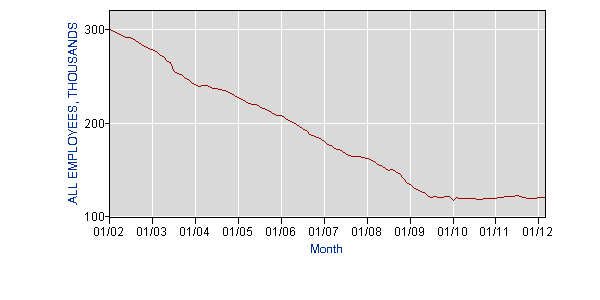
Les produits textiles non finis :
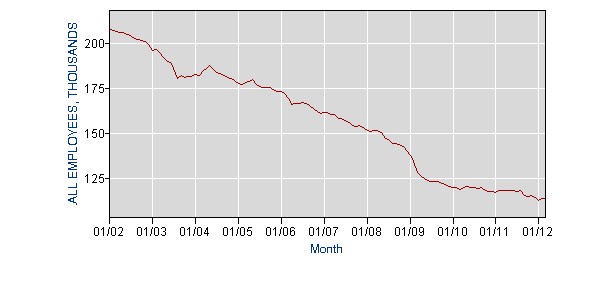
La confection :
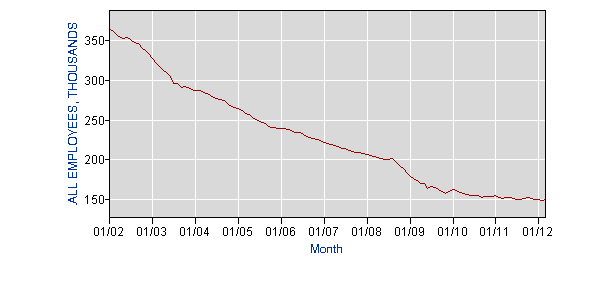
- Selon à peu près le même schéma, le secteur des cuirs et peaux produits associés qui comprend aussi bien les vestes que les bagages et tous les produits en simili connait une petite reprise après des années de perte d’emplois. Mais cette reprise ne représente que 2.000 emplois.
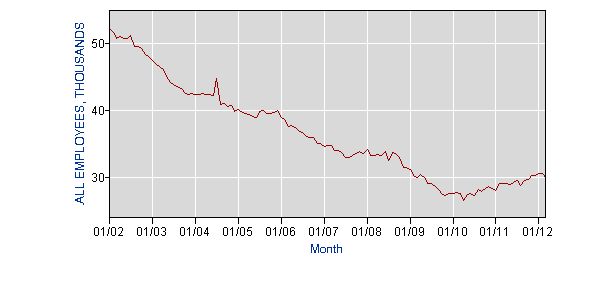
- Comme le textile, l’industrie du papier et de la pâte à papier perd des milliers d’emplois depuis 10 ans mais connait une certaine stabilisation depuis 2010.
Industries papetières et dérivés
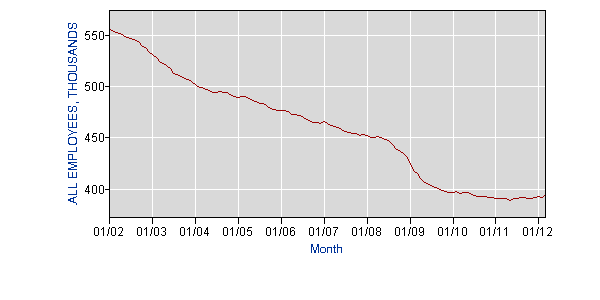
Imprimeries et industries associées qui comprend notamment l’impression de livres et de journaux et qui subit le contre-coup de la déprime du secteur de l’information notamment.
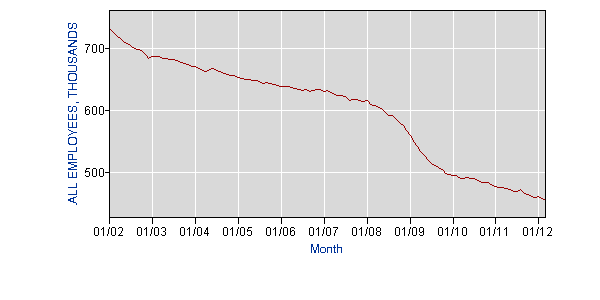
- Pour finir, les produits pétroliers connaissent une évolution parallèle à celle de l’industrie des biens durables dont ils sont un des intrants essentiels. Mais, dans un premier temps, on peut remarquer que l’évolution des emplois dans les industries de distillation ou de fracturation du charbon ou du pétrole sont contra-cycliques : elles embauchent pendant les crises et ont tendance à connaître des creux au moment des reprises.
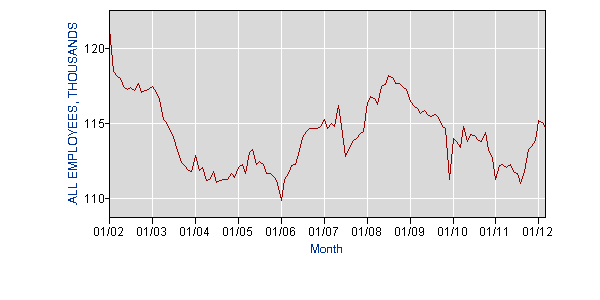
En revanche, les produits chimiques connaissent une évolution similaire à l’ensemble de l’industrie et enregistre, en 2011, une phase de légère croissance des emplois (20.000) inouïe depuis le début des années 2000.
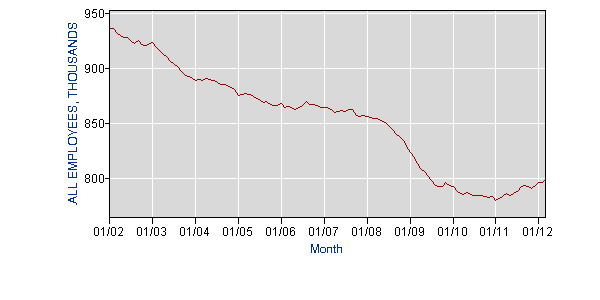
Les produits en plastique et en caoutchouc suivent une courbe similaire. Ces deux derniers secteurs bénéficient de la reprise du secteur de l’automobile, des machines-outils, etc.
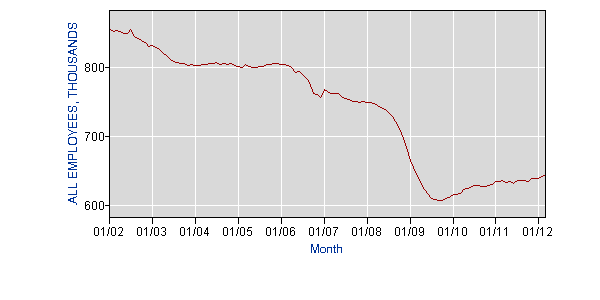
L’industrie américaine : reprise véritable ou simple répit ?
En conclusion, il faut se poser la question de la réalité de cette reprise et si possible de ses conditions de maintien. Or, de ce point de vue, rien n’est sûr. En prenant un peu plus de recul temporel, on se rend compte, comme nous l’avions déjà noté ici, que, malgré la reprise, les effectifs totaux d’employés dans l’industrie américaine sont à des niveaux proches du début des années 50 avec 17-18 millions d’employés. À l’époque, elle représentait un travailleurs sur trois, la population active (civilian labor force) étant de 60 millions de personnes ; elle est aujourd’hui de 154 millions de personnes. En 1979, l’industrie atteint son pic : elle emploie 25 millions de personnes. Un chiffre qui ne sera jamais atteint depuis, mais, durant les années 80-90, elle emploie, en moyenne et avec des fluctuations parfois importantes, autour 23 millions de personnes.
Labour Market : Employment Situation, US from Timetric
Depuis l’an 2000, la chute d’effectif est donc spectaculaire et il possible que la reprise actuelle ne soit qu’un moment de répit, comme en 2004-2006, mais qu’elle ne l’entrave pas. Il faudrait, pour que l’industrie américaine retrouve ses niveaux d’emplois des années 80, une croissance similaire à celle des années 60 ! Une époque dorée car le taux d’équipement des ménages n’était pas ce qu’il est devenu et, parce qu’alors, les Américains achetaient... américain.
Est-ce possible ? Peut-être, mais les conditions de réindustrialisation avancée par le Boston Consulting Group ou l’économie de l’offre avancée par Natixis n’y suffiront probablement pas. La stagnation des salaires américains (tandis que ceux des Chinois augmentent) et l’augmentation de la productivité, la montée du coût du transport maritime, la baisse du prix de l’énergie (boom gazier) associé à la baisse du prix des terrains industriels (dans le sud des États-Unis notamment) sont autant de conditions de réindustrialisation qui ne fonctionneront que si les Américains recommencent à acheter les produits qu’ils fabriquent... parce qu’il y a peu de chance que d’autres le fassent à leur place.
Trade : Balance of Trade, US from Timetric
La balance commerciale américaine se dégrade régulièrement depuis 20 ans et le répit accordé par la crise - en 2009, les Américains, comme les autres, ont ralenti leurs achats - ne fut que de courte durée. Le déficit commercial a, de nouveau, presque atteint son plus bas niveau de 2008. Ce sont surtout les importations de biens qui tirent la balance vers le bas lorsque l’économie repart et qui génère ce paradoxe : plus l’économie mondiale repart, plus les États-Unis exportent (surtout des biens) et plus leur déficit commercial... se creuse. Dans le même temps, en effet, les importations repartent, elles aussi, à la hausse et notamment les importations de pétrole.
La relocalisation de l’industrie usanienne est donc peut-être en marche, mais rien n’est encore joué.
Source de l’illustration : L’industrie automobile de la Caroline du Sud
Renart Saint Vorles est un coureur des bois numériques nord-américains.
[1] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[2] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[3] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[4] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[5] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[6] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[7] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[8] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
[9] Voir la définition et plus d’information ici (en anglais)
Le billet de "Yann", détaillé et documenté, sur le plan de relance de Barack Obama.
Impressions de Pierre-Yves Dugua, journaliste économiste bon teint au Figaro, sur l’économie américaine...
Quand les vessies françaises tentent de ressembler aux lanternes américaines.
Wall-Mart, la chaine géante de magasin arrive-t-elle au bout de sa logique ?
La capitale fédérale était noire, mais avec les chiffres du dernier recensement, elle perd cette particularité.
"quand les types de cent trente kilos disent certaines choses, les types de soixante kilos les écoutent". En économie, c’est aussi vrai qu’ailleurs, surtout dans les salles de marché...